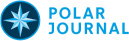Dernières actualités et médias

Ferveur, émotions, souvenirs : les skippers racontent leur cérémonie
Ce samedi 10 mai, les Sables d’Olonne ont renoué avec la magie du Vendée Globe lors d’une grande cérémonie en hommage aux skippers de l’édition 2024. L’événement, très attendu, a rassemblé une foule dense le long du chenal, malgré une météo capricieuse. Entre ferveur populaire et séquences chargées…

L’émotion en grand aux Sables d’Olonne
Ce samedi 10 mai, les Sables d’Olonne se sont embrasés pour célébrer les héros du Vendée Globe 2024-2025. Une soirée exceptionnelle a rassemblé des dizaines de milliers de personnes, entre émotions fortes et souvenirs inoubliables malgré une pluie battante. Dès 18h30, le mythique chenal a vibré au…
Collection bagagerie upcyclée | Vendée Globe

10 mai : une soirée en hommage aux héros du large
Le samedi 10 mai, les Sables d’Olonne s’embraseront une nouvelle fois pour célébrer l’épopée du Vendée Globe et rendre hommage aux skippers de l’édition 2024, lors d’une soirée spectaculaire placée sous le signe de l’émotion et de la fête. Dès 18h30, le mythique chenal s’animera au rythme d’une…

Le livre officiel de la 10e édition déjà disponible !
La 10e édition, celle de tous les records, a déjà son livre officiel, édité par les éditions Hugo Sport (19,95 €). L’occasion de revivre au fil d’un récit richement illustré cette incroyable aventure qui a tenu en haleine des millions de passionnés tout l’hiver.
Charlie Dalin, absent de la remise des prix du Vendée Globe pour raison de santé

« Ici, le Vendée Globe n’est pas un événement, c’est une religion »
Dans le Département qui lui a donné son nom, le Vendée Globe est bien plus qu’une course au large : c’est une affaire de fierté, de partage, et d’émotions. Cette dixième édition, inédite en termes d’affluence et de médiatisation, a animé l’hiver des Vendéens, qui ont vibré aux côtés des marins et…
Nouveau projet 2028 : Ambrogio Beccaria se lance avec Mapei

Qui est vraiment Adélie ?
Adélie, la mascotte du Vendée Globe depuis cette 10e édition, est une espèce de manchot vivant en Antarctique. Récemment, un manchot Adélie perdu et désorienté a été retrouvé sur la côte néo-zélandaise, bien loin de son habitat naturel. Ce phénomène ne constitue pas un cas isolé : les oiseaux de l…
Isabelle Joschke annonce la fin de sa carrière professionnelle de skipper au large

Loïs Berrehar à la barre du nouvel IMOCA Banque Populaire pour le Vendée Globe 2028

Une 10e édition de tous les records !
La 10e édition du Vendée Globe s’achève sur un bilan exceptionnel, tant sur le plan sportif que populaire et médiatique. Jamais le niveau de la compétition n’a été aussi élevé : Charlie Dalin, le grand vainqueur de cette édition anniversaire pulvérise le record de l’épreuve de plus de 9 jours ! Le…
Francesca Clapcich, en route vers le Vendée Globe 2028

Les marins face au casse-tête de Morphée
Gérer son sommeil, ou plutôt l’absence de sommeil. Voilà l’une des compétences clés que doit maîtriser le marin du Vendée Globe, et qui suscite le plus d’admiration et de questions. En cette journée mondiale du sommeil, deux d’entre eux ont accepté de nous livrer quelques secrets de leur relation à…